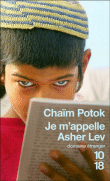 Nous sommes au début des années 50. Asher Lev, un tout petit garçon de la communauté juive hassidique de Brooklyn, a une extraordinaire aptitude pour le dessin. Dans ses mains et déjà dès l’âge de quatre ans, tout devient dessins, images, couleurs : les meubles et les objets de l’appartement dans lequel il habite, sa rue, les gens de son quartier, sa mère, son père, les scènes de leur vie commune. Mais dans une culture comme la sienne, traditionnellement hostile à la représentation figurative, la vocation d’Asher est destinée à créer de durs conflits entre ce don impérieux beaucoup plus fort que lui et l’amour qu’il éprouve pour les siens. « Je déteste ça, c’est perdre son temps. Ça vient du sitra ashra(1). Comme Staline. » (p.61), lui rappelle continuellement son père qui travaille et voyage pour le grand Rèbbe, le chef de la communauté, afin de ramener les juifs à la Torah aux Etats-Unis, mais aussi en Europe, où il faut casser l’isolement causé par la Shoa et les pogroms et persécutions dans les pays de l’Est.
Nous sommes au début des années 50. Asher Lev, un tout petit garçon de la communauté juive hassidique de Brooklyn, a une extraordinaire aptitude pour le dessin. Dans ses mains et déjà dès l’âge de quatre ans, tout devient dessins, images, couleurs : les meubles et les objets de l’appartement dans lequel il habite, sa rue, les gens de son quartier, sa mère, son père, les scènes de leur vie commune. Mais dans une culture comme la sienne, traditionnellement hostile à la représentation figurative, la vocation d’Asher est destinée à créer de durs conflits entre ce don impérieux beaucoup plus fort que lui et l’amour qu’il éprouve pour les siens. « Je déteste ça, c’est perdre son temps. Ça vient du sitra ashra(1). Comme Staline. » (p.61), lui rappelle continuellement son père qui travaille et voyage pour le grand Rèbbe, le chef de la communauté, afin de ramener les juifs à la Torah aux Etats-Unis, mais aussi en Europe, où il faut casser l’isolement causé par la Shoa et les pogroms et persécutions dans les pays de l’Est.
 Comme je l’ai certainement déjà écrit ailleurs, je suis une inconditionnelle de José Saramago. De plus, quand on habite en Italie et qu’on n’en peut plus de Berlusconi, en l’absence d’un parti d’opposition fort et crédible quoi de plus attrayant que les prémices du récit de cet excellent roman, avec ses 83% des électeurs, qui, dans la capitale sans nom d’un pays sans nom, un beau matin décident de voter blanc aux élections municipales ?
Comme je l’ai certainement déjà écrit ailleurs, je suis une inconditionnelle de José Saramago. De plus, quand on habite en Italie et qu’on n’en peut plus de Berlusconi, en l’absence d’un parti d’opposition fort et crédible quoi de plus attrayant que les prémices du récit de cet excellent roman, avec ses 83% des électeurs, qui, dans la capitale sans nom d’un pays sans nom, un beau matin décident de voter blanc aux élections municipales ?
 Pourquoi lire « Chroniques algériennes » aujourd’hui ? Quand on est jeune et qu’on s’éprend d’un écrivain, philosophe qui plus est, - ce qui fut mon cas pour Albert Camus -, on le dévore à pleines dents, puis on thésaurise son œuvre à une place d’honneur et à portée de main, sûr désormais de ce capital érigé en stèle immuable à son propre « confort moral ». Mais ce n’est qu’une illusion, car d’un auteur on ne peut percevoir, comprendre intimement, que ce qui, en nous, correspond de près ou tout du moins de loin à du vécu. C’est ainsi qu’il m’a fallu venir habiter au bord de la Méditerranée pour ressentir pleinement la capacité de bonheur de ce grand homme si sérieux, parfois même austère. C’est ainsi qu’il m’a fallu prendre de l’âge pour bien saisir la profonde intelligence des nuances qui ont caractérisé ses prises de position à l’époque déchirée qui a été la sienne. C’est ainsi qu’il m’a fallu la cacophonie raciste et litigieuse du monde d’aujourd’hui pour que je perçoive celle qui l’a incité, en 1958, à opter pour le silence politique. Alors, aucun doute, c’est bien le bon moment de lire ou de relire Chroniques algériennes.
Pourquoi lire « Chroniques algériennes » aujourd’hui ? Quand on est jeune et qu’on s’éprend d’un écrivain, philosophe qui plus est, - ce qui fut mon cas pour Albert Camus -, on le dévore à pleines dents, puis on thésaurise son œuvre à une place d’honneur et à portée de main, sûr désormais de ce capital érigé en stèle immuable à son propre « confort moral ». Mais ce n’est qu’une illusion, car d’un auteur on ne peut percevoir, comprendre intimement, que ce qui, en nous, correspond de près ou tout du moins de loin à du vécu. C’est ainsi qu’il m’a fallu venir habiter au bord de la Méditerranée pour ressentir pleinement la capacité de bonheur de ce grand homme si sérieux, parfois même austère. C’est ainsi qu’il m’a fallu prendre de l’âge pour bien saisir la profonde intelligence des nuances qui ont caractérisé ses prises de position à l’époque déchirée qui a été la sienne. C’est ainsi qu’il m’a fallu la cacophonie raciste et litigieuse du monde d’aujourd’hui pour que je perçoive celle qui l’a incité, en 1958, à opter pour le silence politique. Alors, aucun doute, c’est bien le bon moment de lire ou de relire Chroniques algériennes.
 « Lucien, étudiant à Port-au-Prince, part manifester lors du bicentenaire de l’indépendance d’Haïti, ignorant qu’il chemine inexorablement vers la mort », résume brièvement le quatrième de couverture de ce livre. Bicentenaire, manifestation, on pense tout de suite qu'on va en apprendre plus sur les révoltes et manifestations qui ont précédés le coup d’état du
« Lucien, étudiant à Port-au-Prince, part manifester lors du bicentenaire de l’indépendance d’Haïti, ignorant qu’il chemine inexorablement vers la mort », résume brièvement le quatrième de couverture de ce livre. Bicentenaire, manifestation, on pense tout de suite qu'on va en apprendre plus sur les révoltes et manifestations qui ont précédés le coup d’état du
L’Histoire humaine, hélas, est pleine de génocides. De mémoire récente celui que les Turcs, en 1915, ont perpétré contre les Arméniens. Préparé dans le plus grand secret par une jeune élite dans un empire branlant, il a fait entre 1 millions et 1 millions et demi de morts en l’espace d’un an et élargi la diaspora(1). C’est ce mécanisme d’une épouvantable efficacité qu’Antonia Arslan, archéologue et ancien professeur à l’université de Padoue, en Italie, raconte dans ce livre, à travers l’histoire de sa famille qu’elle introduit par un bref prologue où elle remonte au dernier souvenir qu’elle a de son grand père, Yerwant Arslanian.
 Voilà un livre que tout le monde devrait lire ou avoir lu, qu’on soit États-uniens ou non, qu’on réside aux Etats-Unis ou non, ne serait-ce que pour mieux comprendre le monde dans lequel nous vivons « aujourd’hui », vu que, sans grande mémoire, notre Europe emboîte sans peur le pas du « magnifique » libéralisme américain.
Voilà un livre que tout le monde devrait lire ou avoir lu, qu’on soit États-uniens ou non, qu’on réside aux Etats-Unis ou non, ne serait-ce que pour mieux comprendre le monde dans lequel nous vivons « aujourd’hui », vu que, sans grande mémoire, notre Europe emboîte sans peur le pas du « magnifique » libéralisme américain.
 Voilà un livre que j’aurais aimé voir. Lire une pièce de théâtre… quoi de plus insipide bien souvent ! J’ai de si mauvais souvenirs scolaires, alors que la passion du théâtre m’a tout de suite submergée dès que j’ai pu m’y rendre régulièrement. Aujourd’hui, à nouveau, il faut que je me contente d’un bouquin. Toujours mieux que rien dans le cas présent. Car les si nombreux messages de Bertolt Brecht, empruntés ici et là parfois, "son testament moral", avec sa référence à l'obscurantisme du nazisme et au mauvais usage qu'on fait parfois de la science d'un côté, et de l'autre, pour moi, l'horrible contexte politique italien actuel, etc. Trois versions successives ou aucune, quelle importance cela revêt-il aujourd’hui ? Le grand thème : la vérité contre le pouvoir, un pouvoir prêt à anéantir tout ce qui l’entrave, tout ce qui pourrait l’affaiblir, par tous les moyens. Brecht pouvait-il choisir une meilleure toile de fond que la vie de Galilée justement, avec toute son ambivalence et ses contradictions ?
Voilà un livre que j’aurais aimé voir. Lire une pièce de théâtre… quoi de plus insipide bien souvent ! J’ai de si mauvais souvenirs scolaires, alors que la passion du théâtre m’a tout de suite submergée dès que j’ai pu m’y rendre régulièrement. Aujourd’hui, à nouveau, il faut que je me contente d’un bouquin. Toujours mieux que rien dans le cas présent. Car les si nombreux messages de Bertolt Brecht, empruntés ici et là parfois, "son testament moral", avec sa référence à l'obscurantisme du nazisme et au mauvais usage qu'on fait parfois de la science d'un côté, et de l'autre, pour moi, l'horrible contexte politique italien actuel, etc. Trois versions successives ou aucune, quelle importance cela revêt-il aujourd’hui ? Le grand thème : la vérité contre le pouvoir, un pouvoir prêt à anéantir tout ce qui l’entrave, tout ce qui pourrait l’affaiblir, par tous les moyens. Brecht pouvait-il choisir une meilleure toile de fond que la vie de Galilée justement, avec toute son ambivalence et ses contradictions ?
Ecrit en portugais, déjà traduit en anglais, en espagnol, en allemand et en italien, ce livre-là attend toujours qu’on le traduise en français. Va savoir pourquoi ! Le récent décès de José Saramago (dont je n’arrive pas à me consoler) aurait certainement servi de rampe de lancement (1). Des francs-parlers courageux comme le sien, aujourd’hui, où faut-il aller les chercher dans un monde aux recrudescences serviles et fanatiques ?
 S’il y a un livre que je suis contente d’avoir lu, c’est bien celui-là, encore plus parce qu’il date de 1971. Car à propos d’une Palestine géographique pas encore pacifiée, il est bon de se remémorer ou peut-être de découvrir la page d’Histoire qui décida, par un vote des Nations Unies, de son partage en deux Etats, un Etat arabe et un Etat juif, le
S’il y a un livre que je suis contente d’avoir lu, c’est bien celui-là, encore plus parce qu’il date de 1971. Car à propos d’une Palestine géographique pas encore pacifiée, il est bon de se remémorer ou peut-être de découvrir la page d’Histoire qui décida, par un vote des Nations Unies, de son partage en deux Etats, un Etat arabe et un Etat juif, le
 Un livre dont tout le monde a entendu parler, ne serait que pour l’attraction de son titre. Mais, l’auteur, Erasme, et la date de parution, 1509, découverts, qui a envie, aujourd’hui, s’il n’est pas un spécialiste, de lire un pamphlet écrit il y a cinq siècles ? Par un moine qui plus est ? Eh bien, qu’on se détrompe, car c’est un délice. Les premiers pions posés dès le début pour aider à la compréhension, Dame Folie comme j'aime appeler cette déesse excuse tout et tous, un chapitre après l'autre : les parents, les enfants, les puissants et les gouvernants, les courtisans et les bouffons, les religions, les prélats et les religieux, les désirs et les vices, les menteurs, les doctes et les ignorants, les femmes comme les hommes, les rois, les guerres, etc., et… dénigre les gens sérieux et honnêtes. On reste choqués par la grande actualité de cette critique acérée, si bien camouflée mais terriblement limpide. Vu qu’on peut le lire gratuitement ici, dans une traduction en français contemporain, en voici un chapitre, le XLVe, qui dans une édition italienne que je possède, paraît sous le titre « Le bonheur se trouve dans l’opinion » :
Un livre dont tout le monde a entendu parler, ne serait que pour l’attraction de son titre. Mais, l’auteur, Erasme, et la date de parution, 1509, découverts, qui a envie, aujourd’hui, s’il n’est pas un spécialiste, de lire un pamphlet écrit il y a cinq siècles ? Par un moine qui plus est ? Eh bien, qu’on se détrompe, car c’est un délice. Les premiers pions posés dès le début pour aider à la compréhension, Dame Folie comme j'aime appeler cette déesse excuse tout et tous, un chapitre après l'autre : les parents, les enfants, les puissants et les gouvernants, les courtisans et les bouffons, les religions, les prélats et les religieux, les désirs et les vices, les menteurs, les doctes et les ignorants, les femmes comme les hommes, les rois, les guerres, etc., et… dénigre les gens sérieux et honnêtes. On reste choqués par la grande actualité de cette critique acérée, si bien camouflée mais terriblement limpide. Vu qu’on peut le lire gratuitement ici, dans une traduction en français contemporain, en voici un chapitre, le XLVe, qui dans une édition italienne que je possède, paraît sous le titre « Le bonheur se trouve dans l’opinion » :




